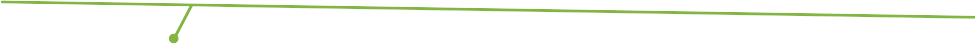Le Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo (RéNAAT) est l’un des trois FAR projets togolais accompagné par le Réseau FAR. Leur projet : la promotion des pratiques climato-intelligentes de production agricole au Togo, à travers notamment la production d’intrants organiques. Dans un atelier bilan réalisé le 2 octobre 2025 au centre SICHEM de Kpomé devant une quarantaine de participants et des médias avec quelques partenaires techniques et financiers Terre et Humanisme, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, le Ministère de l’Agriculture de l’hydraulique Villageoise et du Développement Rural et les membres du réseau, le RéNAAT dresse un bilan satisfaisant et partage les acquis de deux ans de projet.
Un projet expérimental au service de la transition agroécologique
Le projet est né dans un contexte mondial marqué par la flambée des prix des engrais, la crise russo-ukrainienne, et la volonté du Togo d’interdire les intrants chimiques de synthèse, notamment le glyphosate.
Le Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo RéNAAT a bénéficié d’un appui financier de 40 K€ pendant 2 ans (juin 2023 – septembre 2025) de la part du Réseau FAR et d’autres partenaires comme Terre et Humanisme et l’Agence Française de développement AFD pour la mise en œuvre du projet de promotion de pratiques climato intelligentes-disponibilisation des intrants organiques sur l’ensemble du territoire togolais. L’objet réel de ce projet a consisté à lancer une expérimentation à l’échelle du Togo portant sur la production d’engrais organiques en utilisant des techniques « climato-intelligentes innovantes » apportant des solutions alternatives concrètes à l’utilisation des intrants chimiques dans 4 régions du Togo : Maritime, Plateau, Centrale, Kara.
4 centres ont été les piliers de cette expérimentation :
- Le centre d’études et de recherche pour la promotion de l’agroécologie CERPA (région Maritime) ;
- Le centre africain des technologies agroécologiques CADETE (région des Plateaux) ;
- Le centre de formation et d’insertion des jeunes CFIJ-TOGO (région Centrale) ;
- Le centre Foyer agroécologique pour la restauration de l’environnement FARE (région de Kara)
Le centre TMSU International a été le prestataire retenu pour l’installation des équipements de production des bio-intrants
Bilan partagé
Après deux ans de mise en œuvre, quelles sont les activités réalisées, les solutions apportés aux producteurs, les impacts, les défis, les approches de solutions proposées et les leçons à tirer du projet ? Dans un atelier bilan réalisé le 2 octobre 2025 au centre SICHEM de Kpomé devant une quarantaine de participants et des médias avec quelques partenaires techniques et financiers Terre et Humanisme, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, le Ministère de l’Agriculture de l’hydraulique Villageoise et du Développement Rural et les membres du réseau, le RéNAAT dresse un bilan satisfaisant et partage les acquis du projet.
Le bilan du projet a été dressé dans ses grandes lignes par le coordinateur national du projet, M. BOKODJIN Koami.

Activités et réalisations majeures
Investissement en matériels de production des intrants organiques
Chaque centre a été équipé de biodigesteurs, composteurs modélisés et broyeurs multifibres. Ces installations ont permis la production de digestats liquides et solides, d’un compost riche en nutriments, et même de biogaz pour la cuisson et la transformation agroalimentaire.
Renforcement des capacités
La formation en agroécologie à travers les visites d’échanges, la formation par les pairs sur la base des connaissances endogènes couplées de connaissances scientifiques a été un aspect central.
- Des documents pédagogiques, manuel de formation et boite à image sur la production du compost ont été élaborés pour servir d’outils de formation pour les techniciens des centres ;
- 8 formateurs des 4 centres ont été formés sur les mécanismes et processus de fabrication de la fumure organique de qualité et la maitrise des matières premières compostables ;
- 400 producteurs dont 40% de femmes des 4 régions ont été formés en 4 sessions de formation sur les valeurs et les bénéfices d’une utilisation du compost dans la production des cultures et la restauration des sols ;
- 158 jeunes apprenants ont été formés sur la thématique de production de compost pour soutenir les parents producteurs dans l’utilisation et la valorisation du compost ;
- 2 000 producteurs issus des différentes coopératives de production ont été sensibilisés à travers les pairs formés et les émissions radio organisées par les centres lors des sessions de formation ;
- Production et modèle économique de commercialisation de la fumure organique.
Production et commercialisation du compost
Dans les 4 régions, les centres se sont appuyés sur les déchets de fermes, les rebuts de production, les déjections d’animaux essentiellement les volailles, les moutons et les bœufs, les copeaux de bois, la balle de riz, la cendre, le biochar, les fruits mûrs en décomposition comme matières premières pour la production du compost.
Environ 329 tonnes de compost ont été produites sur la période du projet, dont 95,500 tonnes commercialisés auprès des producteurs consommateurs et 97,500 tonnes auto-consommés. Il s’appuie sur la bioéconomie durable qui intègre l’économie verte et l’économie circulaire et qui se résume à la valorisation de la biomasse pour créer des revenues, de la richesse.
Les différents déchets pour la production du compost sont d’abord collectés facilement à des producteurs mais sont ensuite achetés auprès des réseaux de producteurs de ces déchets et des éleveurs pour répondre à la demande de production.
acquis et impacts du projet
Les principaux impacts à souligner sont :
- L’institutionnalisation du réseau RéNAAT à travers le recrutement d’un coordinateur national comme professionnel pour la gestion du projet avec des fonctions qui qui s’étendent sur l’ensemble du réseau et un bureau fixe de représentation à Lomé en co-location avec Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, ce que le réseau n’avait pas depuis sa constitution en 2015 ;
- La vulgarisation des outils pédagogiques élaborés sur le projet, la boite à image, le manuel de formation et le document de capitalisation du projet ;
- L’autonomisation en fumure organique des centres de formation agroécologique à travers les installations des équipements de production. Les centres sont aujourd’hui capables de produire et de consommer leur propre matière organique pour répondre à leurs besoins ;
- La restauration des sols des aires de production par observation dans les centres de formation agroécologiques et l’amélioration de la qualité des produits appréciés par les consommateurs ;
- Les activités génératrices de revenus pour les centres. Les 4 centres produisent suffisamment de la fumure organique qui dépassent leurs besoins et peuvent les vendre sur le marché pour répondre à la demande des consommateurs producteurs agricoles ;
- Pour les producteurs agricoles, le projet a permis de mettre le compost à coût réduit entre de 40 F CFA/Kg à 70 F CFA/Kg à leur disposition pour la fertilité des sols et la réduction des intrants chimiques NPK de synthèse ;
- Un autre impact tangible est la création d’emploi avec le recrutement des jeunes sur la production et la commercialisation du compost. Un total de 20 emplois a été créé dans les 4 centres.
- Des impacts indirects sont la signature de convention sur d’autres projets entre le RéNAAT et d’autres partenaires comme la GIZ avec la formation de 36500 producteurs sur la transition agroécologique avec 40 centres parties prenantes membres du réseau sur le même modèle que le projet DIOAT, un autre partenaire Élevage Sans Frontière avec la construction d’un biodigesteur de 10 m3 à l’IFAD Barkoissi au Nord du Togo pour l’élevage des pintadeaux.
les défis rencontrés
Trois difficultés principales sont ressorties dans la mise en œuvre du projet :
- La disponibilité de la matière première pour la production du compost dans les différents centres. Chaque ferme dispose des têtes de bétail, des volailles et de petits ruminants conformément aux principes agroécologiques. Mais pour la production à échelle et pour rentrer dans un circuit de commercialisation, les déjections de ces animaux et la biomasse des centres se sont avérées insuffisantes. Les centres ont fait recours aux éleveurs pour mobiliser des matières premières avec des impacts sur le volume et le modèle économique du projet.
- La pénibilité du travail de chargement et de retournement des déchets dans le composteur modélisé, le déchargement et le conditionnement du compost mur dans les sacs. Cela nécessite la mobilisation des jeunes en temps partiel pour le travail.
- La collecte des données. Des outils de collecte ont été élaborés et mis en place pour la collecte des données auprès des fermes et un suivi évaluation est réalisé. Cependant la notation des données elle-même s’est avérée fastidieuse auprès des jeunes des centres. Il faut mesurer ou peser chaque matière première pour répondre au dosage d’un chargement, peser tout le lot de compost déchargé, les volumes de digestat liquide utilisé et restant dans le bac de sortie et les noter dans les registres n’a pas été aisé surtout si les jeunes n’ont pas les réflexes et un niveau minimum. Dans le digesteur, le volume d’eau et la masse de la boue de vache à mesurer. Le temps de disponibilité du méthane après chaque chargement du dôme pour la cuisson.
Leçons et perspectives
Le projet réalisé dans les 4 centres peut toujours se poursuivre et générer encore plus de résultats et impacts sur plusieurs aspects après sa fin officielle auprès des bailleurs.
- Pour les centres, il y a une opportunité de réaliser plusieurs études sur l’analyse des sols, la réduction des intrants chimiques auprès des producteurs, l’amélioration du temps et du volume du gaz à travers plusieurs autres biomasses, l’impact économique de l’activité sur le centre etc…
- Une recommandation importante est de renforcer l’élevage dans tous les centres pour rendre disponible la matière première et réduire la dépendance à l’extérieur pour produire suffisamment le compost à moindre cout et mieux le commercialiser pour la pérennité du projet.
- Une plateforme de centralisation des données de production est à renforcer à travers des outils appropriés pour rendre disponible les données et faire les plaidoyers de soutien à l’agroécologie.
- Pour la transition agroécologique, les projets doivent soutenir les grands investissements qui ne sont pas à portée des centres et ou fermes agroécologiques.
Durabilité et pérennisation du projet
Pour la pérennisation du projet, le RéNAAT coordonne toujours les 4 centres qui sont membres. Un travail d’harmonisation des protocoles de production du compost de qualité par région est envisagé.
L’emballage du sac de compost avec la marque RENAAT COMPOST sera amélioré pour une meilleure visibilité du compost et du réseau.
En deux ans, RéNAAT a jeté les bases d’une bioéconomie circulaire et d’une transition agroécologique crédible, au service de la sécurité alimentaire, de la protection de l’environnement et de la création d’emplois ruraux durables.
BOKODJIN Koami
ReNAAT (Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie du Togo)
renaatogo2015@gmail.com