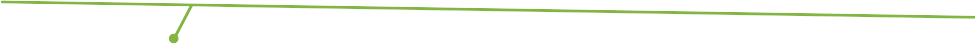Au Maroc, dans les régions Draa-Tafilalet et Souss-Massa, le massif du Siroua fait face à une raréfaction dramatique de l’eau et à une dégradation des sols, affectant directement l’agriculture et l’élevage. Depuis 2017, Migrations & Développement (M&D) agit aux côtés des collectivités d’Assaisse, Zagmouzen et Siroua, en lien avec huit communautés locales, des associations et coopératives, ainsi que des partenaires techniques tels que Terre & Humanisme et son réseau TMED. Soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement, la Fondation Pierre Rabhi, la Fondation SETEC et la Région PACA, le projet AGIR (2017-2025) vise à valoriser les potentialités écologiques, économiques et sociales du territoire pour faire face aux contraintes climatiques, par la mise en place d’une gestion intégrée et collective des ressources naturelles.
Du constat à l’actioN
Dans le massif, la pluviométrie annuelle varie entre 250 et 500 mm, insuffisante pour recharger des nappes phréatiques en baisse constante. Les sols, nus à 96 %, s’érodent rapidement sous l’effet de pluies irrégulières, accentuant le stress hydrique. Ces contraintes fragilisent les activités agro-pastorales, génèrent des tensions sociales entre agriculteurs et éleveurs et accentuent l’exode rural, surtout des jeunes. Face à ce contexte, M&D, en concertation avec les communautés, valorise les pratiques locales résilientes et forme aux techniques agroécologiques (captage des eaux pluviales, mise en défens, agroécologie économisant l’eau, alimentation du bétail à base d’orge germée). L’approche adoptée repose sur la restauration des écosystèmes et la reconnaissance des savoir-faire ancestraux.
Un processus construit étape par étape
Le projet a combiné plusieurs axes. D’abord, l’aménagement participatif du territoire avec la construction de cordons pierreux sur des bassins versants choisis par les habitants, la mise en place de systèmes d’irrigation efficients et de cultures en zone bour. Ensuite, la valorisation des règles coutumières de gestion des ressources (chartes Orf) pour redonner vigueur aux pratiques ancestrales. Des espaces de concertation locale ont été créés, intégrant femmes et jeunes dans les décisions, afin d’ancrer une gouvernance inclusive. Parallèlement, les capacités techniques ont été renforcées, notamment via le compostage, l’hydroponie et d’autres pratiques agricoles économes en eau. Enfin, M&D aspire à essaimer ce modèle, le modèle Toudert, vers d’autres territoires.
Des résultats qui transforment les pratiques
Les formations et aménagements ont touché près de 25 000 habitants des localités ciblées. Parmi eux, 40 femmes et 15 hommes ont été formés aux pratiques agroécologiques, 40 membres d’associations villageoises aux techniques d’hydrologie régénérative, et 15 éleveurs ont bénéficié d’un appui zootechnique. Quinze projets de gestion des ressources ont été initiés, avec 160 membres de communautés locales et 30 élus impliqués dans la concertation. En parallèle, 9 groupements ont travaillé sur l’analyse des débouchés économiques. Les bénéficiaires ont adopté les techniques diffusées et commencent à les partager dans d’autres villages. Les ménages constatent une économie annuelle d’environ 2400 MAD grâce à la réduction des charges de production. L’impact environnemental est visible : meilleure infiltration de l’eau, limitation de l’érosion et retour d’une végétation vingt fois plus dense. Au sein de M&D, les compétences internes ont également été renforcées, avec la formation d’un membre par Terre & Humanisme, désormais relais de diffusion des savoirs.
Leçons et conseils pour la transition agroécologique
Depuis 2017, cette expérience a montré que la gestion intégrée de l’eau est la clé pour restaurer des écosystèmes en crise et apaiser les tensions sociales. Le modèle Toudert illustre l’efficacité d’une approche écosystémique combinant agroécologie et gouvernance coutumière. Les enseignements principaux soulignent que la gouvernance locale constitue un catalyseur de résilience, appuyée sur des règles ancestrales. La concertation avec les populations est indispensable pour établir la confiance et identifier les actions pertinentes. La pleine implication de tous les acteurs doit reposer sur la communication et un cadre clair. Enfin, il convient d’anticiper les inégalités foncières : dans une région où la transmission se fait de père en fils, il est crucial de garantir aux femmes un accès à la terre, notamment via les formations.