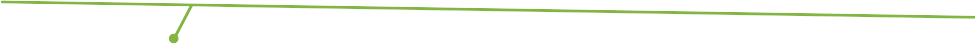Depuis 2015, à Madagascar, l’association Ceffel, membre du groupe Fifata, mène un programme ambitieux pour accélérer la transition agroécologique des exploitations agricoles familiales. En partenariat avec Fifata, Cap Malagasy, Fekama et Fert, cette initiative associe formation, expérimentation et recherche-action. Ancrée dans 12 régions, elle s’appuie sur l’exploitation pédagogique de 20 ha du centre Ceffel comme vitrine et outil de démonstration, et mobilise un vaste réseau de paysans relais et de partenaires pour renforcer l’autonomie et la résilience des producteurs, tout en valorisant leurs savoirs endogènes.
Du constat à l’action
Dans un contexte où la vulnérabilité climatique s’ajoute à la dégradation des sols, à l’insécurité foncière et à la baisse de fertilité, les dispositifs traditionnels de formation agricole, trop normatifs et déconnectés du terrain, montraient leurs limites. Le Ceffel et ses partenaires ont donc misé sur des approches contextualisées et participatives, basées sur l’apprentissage entre pairs, la recherche-action et un conseil de proximité. Cette stratégie vise à placer les producteurs au cœur des décisions, en leur donnant les moyens d’innover et de bâtir des systèmes agricoles durables, ancrés dans les réalités locales.
Un processus construit étape par étape
L’action de Ceffel et de ses partenaires s’articule autour d’un ensemble cohérent d’initiatives qui se renforcent mutuellement. La recherche-action et l’expérimentation, menées en lien étroit avec les producteurs, leurs organisations et les chercheurs, nourrissent en continu les formations. L’exploitation pédagogique de 20 hectares sert de terrain de démonstration et de production de références techniques, tandis que des supports pédagogiques variés livrets, vidéos, outils pédagogiques facilitent la transmission. Des formations ciblent aussi bien les paysans relais que les techniciens et conseillers, et s’accompagnent de l’implantation de champs écoles paysans, véritables lieux d’échanges et de diffusion d’intrants agroécologiques. L’accompagnement s’étend jusqu’aux filières, avec la valorisation des productions sous label SPG, et intègre une approche territoriale innovante grâce à des « jeux sérieux » développés avec le Cirad pour modéliser collectivement les dynamiques locales.
Des résultats visibles à l’échelle nationale
En près de dix ans, plus de 360 paysans relais ont été formés, chacun accompagnant en moyenne une trentaine de producteurs, soit plus de 10 000 bénéficiaires indirects. Sur 250 sites agroécologiques, 150 recherches-actions ont permis de tester et de diffuser des pratiques comme les fertilisants organiques, la lutte biologique, l’agroforesterie, la gestion de l’eau ou les variétés locales. Les rendements ont augmenté en moyenne de 20 %, les charges en intrants ont baissé de 28 %, et les pertes post-récolte ont été divisées par trois. Les produits agroécologiques sont valorisés localement grâce aux SPG, renforçant l’autonomie économique des exploitations.
Leçons et conseils
Cette expérience confirme que la réussite d’une transition agroécologique repose sur la valorisation des savoirs endogènes, une formation adaptée aux réalités locales et un accompagnement dans la durée. Mettre les producteurs au centre garantit l’appropriation des pratiques, et la labellisation SPG accrot la valeur économique des produits. Trois recommandations se dégagent : adapter les formations aux contextes et besoins locaux, en s’appuyant sur des exploitations pédagogiques ; mobiliser une approche systémique et multi-acteurs, intégrant enjeux fonciers, économiques et sociaux ; et coconstruire avec les producteurs des solutions testées et ajustées au fil du temps, pour ancrer durablement le changement.
A lire également : De Madagascar au Maroc, une même ambition : accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique sur fert.fr