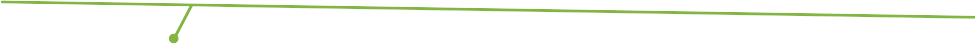Depuis 2014, la France met en œuvre le plan Enseigner à Produire Autrement (EPA), inscrit dans le Projet agroécologique pour la France. Son objectif est de conforter l’engagement de l’enseignement agricole dans les transitions et de faire de l’apprenant l’acteur central du processus. Piloté par le ministère de l’Agriculture et décliné en plans régionaux par les DRAAF et plans locaux, il mobilise les établissements d’enseignement et les exploitations agricoles comme leviers de formation, d’expérimentation et de démonstration. Deux plans EPA ont déjà été réalisés et une nouvelle impulsion politique est prévue en 2026.
Du constat à l’action
La loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 a marqué un tournant en engageant l’agriculture française dans les transitions avec l’ambition de faire évoluer son modèle de production, ambition portée par le slogan « en produire autrement ». Son principe est de combiner performance économique, environnementale et sociale. Elle a dessiné les lignes d’un nouvel équilibre entre pratiques agricoles et compétitivité, en plaçant la transition agroécologique au cœur des préoccupations. Le plan EPA est né de cette dynamique pour engager les établissements et équipes pédagogiques dans la formation des jeunes et actifs aux pratiques durables et plus respectueuses de l’environnement. L’ambition était claire : enseigner autrement pour produire autrement, en intégrant l’agroécologie dans les référentiels, les projets pédagogiques et les démarches de territoire.
Un processus construit étape par étape
Le plan EPA s’est décliné en plans régionaux pilotés par les DRAAF et des plans locaux dans chaque établissement, avec l’appui des établissements du Dispositif National d’Appui (DNA), de l’inspection de l’enseignement agricole et de différents réseaux pilotés par la DGER (référents EPA, éco délégués, etc.). Il a favorisé l’ingénierie pédagogique avec des outils d’animation comme les jeux sérieux ou des méthodes d’analyse et de diagnostic de durabilité (ESR, IDEA4). Les exploitations agricoles et ateliers technologiques des établissements sont des supports de démonstration et d’expérimentation, par la réduction des intrants, la conversion à l’agriculture biologique ou la certification environnementale. Enfin, EPA a favorisé des dynamiques territoriales via des partenariats, des journées techniques et des projets collectifs.
Des résultats qui transforment les pratiques et les mentalités
Le plan a renforcé la visibilité des établissements et la synergie interne des équipes, avec un rôle moteur des exploitations agricoles. Il a permis un foisonnement de projets pédagogiques et une mobilisation des communautés éducatives sur les questions environnementales, avec des actions très concrètes allant du tri des déchets à l’approvisionnement durable des cantines mais surtout une approche globale des problématiques posées. Tous les référentiels de diplômes ont été rénovés, favorisant un changement de paradigme dans l’approche pédagogique : passage de la pédagogie de la solution à la pédagogie du questionnement et de la co-construction des savoirs. Les apprenants prennent davantage la parole et s’engagent sur les enjeux de transition. Toutefois, des disparités demeurent, certains enseignants restants insuffisamment outillés et un essoufflement se faisant sentir, appelant une nouvelle impulsion.
Leçons et conseils
L’expérience montre l’importance du travail collectif et de la synergie entre enseignement, recherche et développement. Le changement demande du temps, tant pour transformer les pratiques pédagogiques que pour accompagner le changement des représentations. L’implication de tous les acteurs (directions, formateurs, apprenants, professionnels, enseignement supérieur) est recherchée. Enfin, il importe de placer les apprenants en situation d’agir (approche capacitaire), au travers d’un ancrage de l’enseignement et de l’évaluation dans des situations réelles de la vie sociale et/ou professionnelle.
CONTACT

Christian CANDALH
Inspecteur de l’enseignement agricole Sciences et techniques de l’Agronomie
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche, Inspection de l’Enseignement Agricole, France
christian.candalh@agriculture.gouv.fr