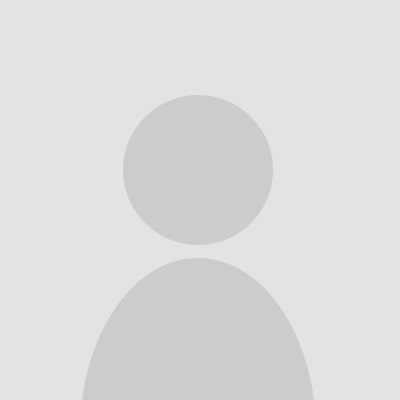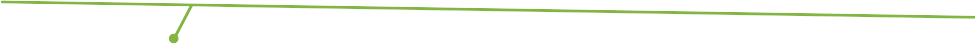Le projet COSTEA, mené entre plusieurs pays africains et appuyé par des partenaires techniques et scientifiques, vise à accompagner la transition agroécologique par l’intégration d’outils pédagogiques et méthodologiques adaptés aux réalités locales. L’objectif est de renforcer les systèmes de formation agricole et rurale afin de mieux répondre aux exigences écologiques, économiques et sociales. Construit sur une dynamique collective et participative, il a déjà permis la mobilisation de nombreux acteurs et la production d’outils de référence qui servent directement à la formation et au conseil en agriculture durable.
Du constat à l’action
L’expérience est née du constat partagé par les partenaires qu’il existe un décalage entre les besoins des producteurs face aux changements climatiques et les contenus des dispositifs de formation. Dans plusieurs pays, les systèmes agricoles souffrent encore d’une forte dépendance aux intrants chimiques et d’une vulnérabilité marquée aux aléas climatiques. Les pratiques agroécologiques, pourtant reconnues pour leur potentiel de durabilité, restaient marginales ou difficilement accessibles aux producteurs et aux formateurs. Il est donc apparu essentiel de mettre en place des dispositifs innovants capables de rapprocher la recherche, la formation et le terrain, tout en valorisant les savoirs locaux et en créant une synergie internationale.
Un processus construit étape par étape
Le projet s’est appuyé sur une méthodologie progressive et participative. Des diagnostics partagés ont permis d’identifier les besoins des différents publics, des producteurs aux conseillers agricoles. Des ateliers de co-construction ont ensuite réuni chercheurs, formateurs et professionnels pour élaborer des outils pédagogiques adaptés. Des modules ont été expérimentés dans plusieurs centres de formation et enrichis par des retours de terrain. La démarche a combiné observation, analyse, expérimentation et diffusion, afin que chaque étape s’ancre dans une logique de capitalisation et de mutualisation. Le travail en réseau a facilité la diffusion des connaissances et la montée en compétences des formateurs.
Des résultats qui transforment les pratiques et les mentalités
Le projet a produit plusieurs résultats marquants. Des outils pédagogiques contextualisés ont été conçus et mis à disposition des centres de formation, intégrant des contenus sur l’agroécologie, la gestion durable de l’eau et la préservation des sols. Des formateurs ont renforcé leurs compétences en pédagogies actives, ce qui leur a permis d’animer des séances plus interactives et ancrées dans la réalité des exploitations. Pour les producteurs accompagnés, la valorisation des savoirs locaux et la mise en pratique de nouvelles techniques agroécologiques ont ouvert des perspectives concrètes de durabilité et de résilience. Le projet a également renforcé le dialogue entre institutions, donnant plus de légitimité à l’agroécologie dans les stratégies de développement agricole.
Leçons et conseils
Plusieurs enseignements se dégagent de cette initiative. Elle montre d’abord que l’intégration des transitions agroécologiques dans la formation exige un travail collectif qui associe les producteurs, les formateurs, les chercheurs et les décideurs. Elle souligne également l’importance de partir des savoirs endogènes et des réalités locales pour bâtir des contenus adaptés et durables. Enfin, elle met en avant le rôle clé des pédagogies actives et de la coopération internationale dans l’ancrage des changements. Pour capitaliser cette expérience, il est recommandé de renforcer la formation des formateurs, de systématiser l’évaluation participative des outils créés et de consolider les partenariats entre institutions pour élargir l’impact et favoriser la pérennisation des acquis.