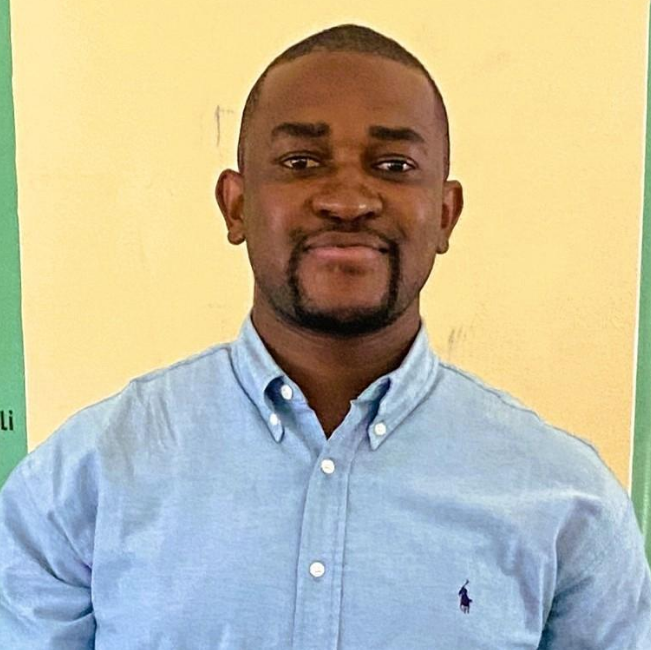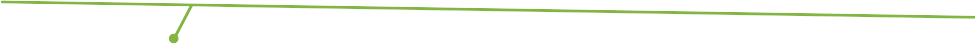Au Cameroun, l’équipe PCP-AFOP/SECAL place les producteurs au cœur de son action, avec l’ambition de réveiller leur génie créateur pour qu’ils élaborent eux-mêmes des solutions agroécologiques adaptées à leur environnement et à leur système de production. L’approche s’appuie sur un diagnostic systémique et holistique co-construit avec eux, et se distingue par l’implication active des professionnels et acteurs locaux dans la formation et son évaluation.
Du constat à l’action
De 2015 à 2023, l’AFOP a accompagné l’installation de 5 000 jeunes porteurs de projets agricoles destinés à répondre aux besoins des marchés et de la sécurité alimentaire. Mais depuis 2022, ces projets, fondés sur l’agriculture conventionnelle, se heurtent à l’inflation des prix des intrants, à l’évolution des réglementations environnementales notamment dans la filière cacao et aux effets du changement climatique conjugués à la perte de biodiversité. Le projet SECAL a été conçu pour renforcer la résilience des systèmes de production par l’intégration de l’agroécologie. Initiée dans la formation initiale, cette démarche a été élargie à la formation continue, mobilisant savoirs endogènes, références techniques et opportunités des marchés bio.
Un processus construit étape par étape
Le dispositif a débuté par des missions exploratoires visant à identifier et capitaliser les expériences existantes en agroécologie. Un guide méthodologique de diagnostic des exploitations a ensuite été élaboré, accompagné de six modules de formation-action portant respectivement sur :
- les principes, concepts et variantes de l’agriculture durable : construction de l’adhésion des acteurs et d’une vision commune ;
- la conduite de diagnostic holistique et systémique de l’exploitation agropastorale avec prise en compte de l’agroécosystème ;
- la construction des alternatives de solutions agroécologiques aux contraintes hiérarchisées de l’exploitation ;
- la pédagogie applicable pour la formation continue en agroécologie ;
- les démarches et outils d’accompagnement des exploitants aux transitions agroécologiques ;
- le suivi-évaluation orienté changement en matière d’accompagnement aux transitions agroécologiques
La mise en œuvre des pratiques agroécologiques s’appuie sur ce corpus, en intégrant étroitement les producteurs et les accompagnants dans toutes les étapes.
Des résultats tangibles
L’initiative a permis de capitaliser les expériences et initiatives existantes, de finaliser le guide de diagnostic et de produire les sept modules de formation. Les capacités de l’équipe agroécologie ont été renforcées : huit formateurs des accompagnants, dix personnes ressources et cinquante-cinq accompagnants sont aujourd’hui formés aux démarches et outils d’accompagnement à la transition agroécologique.
Des changements visibles sur le terrain
Sur le plan des résultats concrets, l’agroécologie a amélioré la qualité des systèmes alimentaires et renforcé la biodiversité des agroécosystèmes. Elle a favorisé l’usage d’intrants à base de produits naturels, disponibles localement et moins coûteux, tout en stimulant le développement des semences paysannes et de la pharmacopée traditionnelle.
Sur le plan organisationnel, deux nouveaux postes dédiés à l’agroécologie ont été créés au niveau national, et des équipes d’accompagnants ont été mises en place dans les territoires. Le fonctionnement interne a gagné en transversalité, avec un travail pluridisciplinaire impliquant l’équipe AFOP/SECAL, les personnes ressources et les producteurs. La pédagogie a été revue pour intégrer pleinement l’agroécologie, et les formations continues s’appuient désormais sur des ateliers pédagogiques implantés dans les exploitations. Enfin, le dispositif de suivi-évaluation a été orienté vers la mesure du changement.
Leçons et conseils
Cette expérience a confirmé que l’agroécologie n’est pas une recette universelle, mais un choix raisonné du producteur, qui doit être accompagné par un formateur-méthodologue plutôt que par un simple spécialiste technique. L’agroécologie s’inscrit dans une analyse systémique et territoriale, mobilisant tous les acteurs pour renforcer les capacités des producteurs et stimuler leur créativité. Les périodes de diagnostic et de formation continue doivent être alignées sur le calendrier agricole.
Pour réussir, tous les acteurs impliqués doivent être convaincus des forces et des limites de l’agroécologie, tout en respectant la décision finale du producteur. Il est essentiel de repenser le compte d’exploitation pour intégrer les coûts et bénéfices souvent invisibles à moyen et long terme, en associant tous les acteurs à l’évaluation. Enfin, les apprentissages doivent se dérouler en milieu réel, au contact direct des conditions et contraintes du terrain.